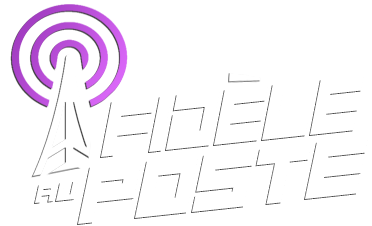Issu d’une famille musicienne (grand-père griot et percussionniste, maman chanteuse), Richard Bona naît à Minta, au centre du Cameroun, en 1967. Ses proches évoquent un enfant capricieux, qui pleurait tout le temps, jusqu’au jour où des musiciens sont venus passer une journée dans la maison familiale. Fasciné par le balafon, Richard, qui a alors quatre ans, trouve sa voie pour sécher ses larmes et son grand-père lui offre son premier instrument. Un an plus tard, il joue dans l’église de son village natal avec sa mère et ses quatre soeurs.
Très vite, il se taille une solide réputation et ses prestations sont appréciées lors des baptêmes, mariages et autres cérémonies. Comme nombre de musiciens africains, Richard doit faire preuve d’imagination pour fabriquer ses instruments. Ingénieux bricoleur, il conçoit sa guitare à douze cordes avec des câbles de freins de vélo.
À l’âge de 11 ans, Richard suit son père qui vient de trouver un emploi de camionneur à Douala, la capitale économique du pays. Ses camarades d’alors le surnomment Fantômas car on ne le voit pas beaucoup à l’école, l’apprenti musicien préférant s’entraîner des heures entières sur ses instruments de fortune. Le soir, il lui arrive de faire le boeuf avec son surveillant général (qui n’est autre que Messi Martin, le maître du bikutsi moderne), qu’il rencontre plus souvent dans les clubs de la ville que sur les bancs de l’école. Au bout de quelques mois et grâce à ses premiers contrats, Richard peut enfin s’acheter une vraie guitare.
En 1980, Richard Bona rencontre un Français expatrié qui tient un club de jazz. Il lui propose de créer un orchestre de jazz en quelques semaines pour une somme d’argent inespéré pour le gamin de Minta. Richard, qui n’avait jamais entendu parler du jazz, passe ses jours et ses nuits à explorer cette musique, jusqu’à la révélation en écoutant un disque de Jaco Pastorius. Enthousiasmé par la vélocité du jeu du bassiste de Weather Report, il se convertit aussitôt à ce nouvel instrument.
En 1995, il est finaliste du concours Découvertes de Radio France Internationale, avec « Eyala », une ballade acoustique inspirée par la tragédie de la guerre en ex-Yougoslavie, qui séduit le jury. La fin de l’aventure française s’achève en 1995 lorsqu’il triomphe dans une salle branchée de la capitale, le Hot-Brass.
Cette année-là, la France ne lui reconduit pas son titre de séjour, les autorités prétextant que 1604 (!) bassistes français sont au chômage. Déçu, Richard ne compte que sur son talent et s’envole pour les États-Unis où il réside désormais. New York, cosmopolite et reconnaissanteÉLÉGANCE envers les talents d’exception, semblait attendre le bassiste prodige camerounais.
À New York, Richard Bona multiplie les engagements dans les clubs de jazz. Jake Holmes, auteur de nombreux succès pour Harry Belafonte, le remarque et l’engage comme directeur musical sur les spectacles du fameux crooner américain. La liste de ses collaborations avec les plus grandes stars américaines est longue, Richard se glisse dans l’univers de chacun avec une étonnante facilité. De Paul Simon à Chaka Khan, de Queen Latifah à Harry Conick Jr, en, passant par Tito Puente, George Benson, Herbie Handcock ou encore Bobby Mc Ferrin. Il travaille avec des musiciens de tous horizons, toujours en quête de nouvelles sensations musicales, dans le jazz, la salsa et même la country! Nombre de bassistes au chômage en France doivent envier un tel palmarès, et finalement, le non-renouvellement de sa carte de séjour a sans doute été, pour Richard Bona, la chance de sa vie.